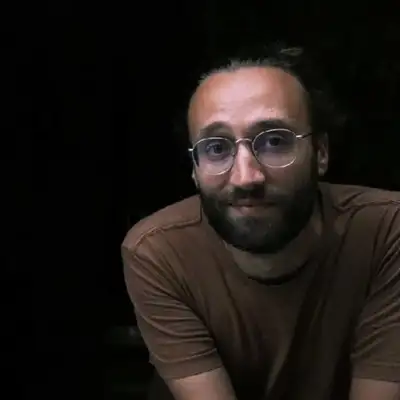[Rediff] Y a-t-il un problème avec les écrans ? avec Séverine Erhel
Télécharger MP3Sous-titres générés avec IA (Whisper), editing et proofing par Guglielmo Fernandez Garcia.
Entre 3 et 4 heures par jour, c'est le temps que je peux passer sur mon téléphone d'après
sa fonction temps d'écran.
Si ce chiffre, je le trouve plutôt important, il me paraît presque effrayant quand je me
dis qu'il ne prend pas en compte les heures passées sur ma console ou sur mon ordinateur.
Et quand je discute avec mon entourage, j'ai l'impression qu'on est tous un
peu pareils, pris dans la spirale infernale de nos écrans connectés.
Mais qu'est-ce que cela veut dire de nous ?
Avec Guglielmo, on s'est posé la question de la place de tous ces écrans,
de tous ces dispositifs numériques dans nos vies.
Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à ce que nous font vraiment les écrans
et au discours alarmiste qu'on a déjà tous entendu.
Pour ce faire, nous avons eu le plaisir de discuter avec Séverine Ehrel,
maître de conférences en psychologie cognitive à l'université de Rennes 2 de,
et spécialiste de notre sujet.
Entrons tout de suite dans le vif du sujet avec la grande question de cet épisode.
Avons-nous vraiment un problème social avec les écrans ?
Aujourd'hui, on a une panique morale avec les écrans.
Très clairement, aujourd'hui, on regarde dans la presse la quantité d'articles,
dans la presse, dans les médias en tout cas,
la quantité d'articles qui ont été dédiés aux écrans est énorme,
beaucoup plus importante en tout cas que la littérature scientifique.
Donc on peut dire que dans ce contexte-là,
on est en fait dans une panique morale.
Est-ce qu'il y a un problème ensuite concrètement et réellement avec les écrans ?
Pour moi, il n'y a pas un problème global d'écrans
parce qu'en fait, on est beaucoup à les utiliser sans trop de difficultés.
Par contre, ce qu'on commence à se dire au niveau de la littérature,
c'est qu'il y a en fait des profils socio-économiques, psychologiques
qui ont en fait des fragilités qui les conduisent à avoir en fait,
par exemple, des usages problématiques des écrans
ou qui les amènent à avoir des problèmes de santé mentale associés aux écrans.
Donc l'idée aujourd'hui dans la littérature scientifique,
c'est d'essayer de comprendre justement quels sont ces prédicteurs
chez ces personnes qui rencontrent des difficultés avec le numérique.
L'idée, c'est pas de dire tout le monde aussi a des problèmes avec le numérique,
mais plutôt d'essayer de quantifier le nombre de personnes
en fait qui développent ce qu'on appelle des usages problématiques.
Alors je vous parlerai jamais d'addiction.
Et l'idée, c'est d'essayer de voir quels sont ces usages problématiques
et surtout d'essayer de mieux comprendre à quoi ça réfère.
Donc est ce qu'on a un usage problématique de l'internet au global
ou des usages problématiques spécifiques,
c'est à dire associés à des activités particulières.
Et il semblerait plutôt que ce soit ça.
Est ce que les toutes premières écrans ont été accueillies
aussi avec autant de réactions d'inquiétude ?
Si on reprend la grande histoire des paniques morales,
c'est beaucoup centré déjà au niveau des activités de loisirs.
Donc pas tout de suite des écrans, des activités de loisirs.
Donc si tu prends, par exemple,
si tu fais un petit retour en arrière dans l'histoire,
on arrive dans les années 30-40,
on retrouve une panique morale qui concerne les flippeurs
parce qu'en fait, on passe du temps à jouer.
Et du coup, pendant ce temps-là,
les personnes, les politiques de l'époque se plaignaient justement
de jeunes qui devenaient oisifs, qui ne cherchaient plus de travail
et qui dépensaient tout leur argent dans des flippeurs.
La panique morale qui concerne aujourd'hui les écrans,
on la voit plutôt apparaître dans les années,
on va dire, 90,
avec des jeux vidéo qui vont commencer justement à faire peur.
Alors le premier jeu vidéo qui a commencé à faire peur, d'après vous, c'est quoi ?
Une des 90 ?
Bah Doom !
Donc Doom, grand jeu vidéo, grande licence en fait de jeux vidéo.
Doom en fait a été beaucoup incriminé par rapport à l'addiction qu'il pouvait causer
et aussi par rapport à la violence en fait.
Et puis ensuite, on voit apparaître des paniques morales autour de...
Plus récemment, de League of Legend,
mais on a eu d'autres jeux, alors je pense à...
Mortal Kombat ?
Mortal Kombat, voilà.
Je me souviens, ouais, ouais, ouais.
Ou là, on va dire aussi, oui, ça crée de la violence chez les jeunes
ou ça crée, entre guillemets, de l'addiction, etc.
Donc voilà.
Donc on voit dans les années 90 poindre ça.
Et puis c'est vrai qu'on est quand même sur des jeux
qui sont plutôt des jeux de consoles ou d'arcades
qui ne sont pas non plus très envahissants, mais bon, voilà.
Et puis là, depuis les années 2010, 2015,
on voit vraiment en fait cette panique morale sur les écrans apparaître.
C'est pas spécifique à la France.
On retrouve en fait cette panique morale aux États-Unis.
Et donc c'est essentiellement lié à l'apparition des smartphones,
pour être très clair.
Quand on a écrit cette question, on s'est dit,
bah, probablement qu'elle va nous parler en premier de l'apparition de la télévision.
Est-ce qu'il y a eu une panique morale similaire quand la télévision est arrivée ?
Je sais qu'il y a eu énormément de questions.
Je sais pas si c'est monté au point d'être une panique morale,
mais je sais qu'il y a eu énormément de questionnements
dans les années 80 sur...
On passe beaucoup trop de temps devant la télé, etc.
Sauf que si on fait un tour de la littérature, en réalité,
la télévision n'a pas en tout cas décérébré toute une génération,
puisque j'en fais partie, en fait, et ça va.
Et c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps devant la télé.
En réalité, la télévision n'a pas eu d'effet négatif,
en tout cas sur les compétences cognitives.
Un peu plus sur l'obésité, mais c'est une autre histoire.
Il est important de préciser deux points dans nos discussions avec Severine.
D'une part, nous ne parlons avec elle qu'à des effets psychologiques
et non des effets physiques, comme par exemple la paire de vues.
D'autre part, nous parlons des effets sur les adolescents et les jeunes,
sans aborder d'autres sujets tels qu'à partir de quel âge
doit-on commencer à exposer les enfants aux écrans.
En tout cas, il nous semble à Alex et moi
que lorsqu'on parle des écrans, il y a un angle mort dans les débats publics.
Moi, par exemple, j'utilise un écran pour travailler,
pour lire le journal ou regarder un film avec ma compagne.
D'autres, par exemple, les utilisent pour jouer au jeu vidéo.
Ce sont des activités qui me paraissent très différentes.
Il ne faudrait pas distinguer les aspects quantitatives,
c'est-à-dire les temps passés devant un écran,
et les aspects qualitatives, c'est-à-dire ce qu'ils ont fait sur les écrans.
Alors déjà, pour revenir sur la notion d'écran.
Alors vous avez dit tout à l'heure, je suis chercheuse sur les écrans,
donc je n'ai rien dit, mais en fait, je suis chercheuse sur les environnements numériques.
Je vais vous expliquer pourquoi,
parce qu'en fait, pour moi, les écrans, ça n'envoie à rien de concret.
Pour l'écran, c'est un dispositif d'affichage.
Là, j'ai ma tablette, j'écris des choses, dessus, c'est un écran.
L'écran de la montre connectée, c'est un écran.
Donc, en fait, c'est juste un dispositif d'affichage.
Donc, à partir de ce moment-là, en fait,
ça n'envoie à pas grand-chose, et c'est une sorte d'immense fourre-tout,
en fait, quand on va dire les écrans,
ça renvoie aux tablettes, aux ordinateurs,
aux écrans publicitaires animés en ville, etc.
Enfin, ce qu'il en reste.
Le temps écran, c'est aussi un problème en soi,
parce qu'en fait, quand on fait, quand on parle du temps écran,
souvent, on va dire, tu fais trop d'écrans, tu passes tout ton temps dans les écrans.
En fait, concrètement, quand on fait du temps écran,
en fait, on peut faire plusieurs choses.
Par exemple, si je vais prendre un café avec vous
et que je vous parle de la dernière vidéo à la mode de Rennes 2 sur les barricades,
en fait, je vous la montre.
Et en même temps, on en discute.
Donc, c'est du temps médié,
ce n'est pas du temps purement écran, puisqu'on en discute, en fait.
Donc, il y a un problème de mesure du temps écran.
Ensuite, ce temps écran, comme je le disais,
on part du principe que plus on fait du temps écran et plus c'est problématique.
Sauf qu'en réalité, la science ne dit pas tout à fait la même chose.
Donc, les articles, en fait, disent que on va développer des usages problématiques
et des usages problématiques,
ça ne veut pas forcément dire qu'on passe trop de temps sur les écrans,
même si bon, il faut essayer d'être raisonnée.
L'usage problématique, c'est quand on a en fait
un usage compulsif et excessif des écrans
qui conduisent à des conséquences négatives dans la vie quotidienne.
Et ce n'est pas tout à fait la même chose.
Ça veut dire que ça n'inclut pas, par exemple, les usages des passionnés.
Si vous êtes un passionné, par exemple, de League of Legends
et que vous passez 20 heures par semaine à jouer à League of Legends,
bon, ce n'est pas idéal, en tout cas, pour votre activité sportive,
mais vous êtes un passionné, vous n'êtes pas un addict aux écrans.
Donc, la question du temps écran, en fait, il faut essayer d'en sortir
et plutôt, comme tu le disais, parler plutôt d'activités et de pratiques.
À mon sens, ce qui pose problème, ce n'est pas en soi
les écrans ou le temps écran.
C'est plutôt en fait des activités
ou des pratiques qui peuvent être bonnes et d'autres activités
ou d'autres pratiques qui peuvent être délétères pour des populations
données dans un contexte situé.
Alors, un exemple précis, le multitasking
est une mauvaise pratique chez les étudiants.
C'est ce que j'ai pu mesurer à travers une étude, notamment en fait
chez les 18-25, 18-30 ici.
Donc, c'est une mauvaise pratique, surtout en fait,
quand on fait ça pendant les cours ou quand on est en train
de faire des activités, d'apprendre, de révision à la maison.
Donc voilà, donc l'idée, maintenant, aujourd'hui, à mon sens,
et on est plusieurs chercheurs à aller en fait dans ce sens,
c'est plutôt d'essayer en fait,
plutôt que de stigmatiser globalement les écrans ou de dire
tout le monde fait trop de temps écran,
donc il y a un temps excessif, on peut être d'accord là-dessus,
qu'il faut mieux éviter, mais plutôt en fait,
essayer d'identifier les activités qui sont bonnes,
les activités ou les pratiques qui sont délétères
et ensuite essayer en fait de produire des recommandations sanitaires par rapport à ça.
Ce fameux temps d'écran ne serait donc pas la meilleure démétrique
pour juger si l'usage d'un dispositif numérique est problématique.
Pourtant, j'ai l'impression que c'est parce qu'on a observé
que le temps qu'on passait sur les écrans pouvait être important,
qu'on s'est mis à paniquer.
D'où ma question, comment s'est construite
cette panique morale dont on parlait en début d'émission ?
Le problème de la panique morale, c'est qu'on va se retrouver
en fait dans une situation où des gens vont commencer
à dire il y a peut-être un problème par rapport à ça.
Les médias vont s'en emparer, des experts médiatiques vont être appelés.
Et ce n'est pas toujours des vrais experts,
parce que pour moi, un vrai expert, il a en fait des publications,
enfin un vrai expert sur qui on peut demander en fait
un avis scientifique, il a des publications
et il publie effectivement sur le thème sur lequel il s'exprime.
Et quand je dis publication, ce n'est pas des billets de blog,
c'est des publications dans des revues à comité de lecture,
idéalement internationales.
On l'a en fait dans la panique morale,
donc on va avoir un emballement médiatique,
plus des experts autoproclamés qui vont venir
prendre ce sujet-là et éventuellement,
on peut se le dire, se faire un petit peu d'argent au passage
via des coachings, des conférences, des livres, etc.
Et ensuite, dans ce phénomène de panique morale,
ce qui est en train de se passer au niveau des écrans,
les politiques vont s'en emparer et puis vont essayer
de redonner le problème aux chercheurs.
Le problème, c'est qu'il y a un problème de timing dans tout ça,
c'est-à-dire que dans la panique morale,
tout ça va se passer très vite.
Le temps de recherche, ce n'est pas tout à fait le même temps,
il est beaucoup plus long que le temps médiatique.
Donc nous, on se retrouve en difficulté à essayer de collecter,
de courir après la littérature, les études pour essayer de fournir des choses.
Et parfois, on n'a pas de réponse
ou pas encore de réponse ou pas de consensus scientifique,
ce qui est le cas notamment sur la question des écrans.
Et du coup, on est en difficulté, on nous dit voilà,
vous ne pouvez pas répondre, etc.
Quand on n'a pas forcément de culture universitaire,
une question quand même qui se pose, c'est comment on arrive au consensus?
Comment on arrive au consensus, il faut qu'on ait en fait
un bon niveau de preuve, c'est-à-dire un ensemble d'études
qui vont en fait pointer dans le même sens.
Et cet ensemble d'études peut être regroupé
à travers ce qu'on appelle des méta-analyses.
Donc, c'est des groupements d'études qui vont être analysés
selon une méthode particulière.
Donc, on va faire une revue systématique de la littérature,
c'est-à-dire qu'on va prendre, par exemple,
si on veut faire une évaluation du réseau social Instagram,
par exemple, sur les jeunes filles ou des réseaux sociaux
basés sur l'image sur les jeunes filles,
on va rentrer des mots clés en fait dans les bases de données,
on va récupérer toutes les études sur cette question,
on va regarder la qualité de ces études, on va trier.
À la fin, on va regarder une partie de ces études
et on va faire des analyses statistiques
pour montrer en fait la taille de l'effet.
La taille de l'effet, c'est dans quelle mesure, en fait,
on a en fait des fortes associations
entre la variable que l'on teste et puis ces différents prédicteurs.
Et à partir de là,
ben en fait, quand on a une méta-analyse
qui pointe sur un effet délétère, par exemple, des réseaux sociaux
basés sur l'image pour les jeunes filles,
puis deux méta-analyses,
ben en fait, les chercheurs commencent à s'entendre
et discuter au cours de symposiums, de groupes de recherche.
Et là, en fait, on arrive à poser un consensus,
sachant qu'un consensus, ce qui est un peu compliqué,
c'est qu'il n'est jamais non plus figé dans le temps.
Donc, du coup, aujourd'hui, on pourrait avoir un consensus
sur un fait particulier, par exemple,
on peut avoir un consensus en physique,
mais si on fait une nouvelle découverte,
ben du coup, le consensus ne tient plus.
Bon, bien que cela puisse sembler s'écarter de notre sujet,
je suis vraiment reconnaissant à Séverine
pour cette explication du fonctionnement de la recherche scientifique.
C'est sans les communautés des chercheurs et chercheuses
qui font la science, et non l'article individuel.
Il faut toujours être prudent lorsqu'on lit
à un groupe de chercheurs qui a découvert une certaine chose.
En même temps, le fait que la recherche tente de comprendre
ces usages problématiques me réconforte,
car les appareils numériques sont souvent entrés dans notre intimité,
là où c'est plus difficile d'y voir clair.
J'essaye alors de creuser un peu plus ces usages avec elle
avec une certaine crainte de me retrouver dans la description qu'elle pourrait en faire.
Sur les usages problématiques,
qui est un phénomène qui touche plus la santé mentale,
qu'est-ce qui peut se passer ?
Donc par exemple, en fait, on peut avoir un étudiant
qui va commencer à jouer, qui va passer en fait beaucoup de temps sur les réseaux sociaux.
Donc il va se lever le matin et puis dans les 15 minutes de son lever,
il va consulter, je sais pas, TikTok.
Et puis, en fait, ensuite, il va être sur TikTok
et déjà, en fait, on va voir qu'il va oublier, en fait, l'heure de son cours
et en fait, il se rend compte que finalement, il n'a pas été en cours.
Et en fait, arrivé en cours, voilà,
il commence à faire du multitasking avec TikTok, etc.
Donc là, en fait, on peut arriver, en fait,
parfois sur un usage qui va être envahissant du réseau social,
donc un usage problématique du réseau social,
qui va conduire à des conflits intrapsychiques.
Donc je vais avoir de la culpabilité parce que je passe trop de temps là-dessus.
Et puis, des conflits aussi interpersonnels.
Donc ma copine me dit que je passe trop de temps sur les réseaux sociaux
et donc, du coup, on se dispute ou mes parents me disent que je ne les écoute pas, etc.
Et puis, on peut aussi avoir des problématiques autour simplement,
en fait, des performances scolaires.
C'est-à-dire, je passe trop de temps, j'oublie d'aller en cours.
Quand je suis en cours, je pense à ça, c'est un peu envahissant.
Là, en fait, on est sur un usage problématique.
Un usage problématique, c'est vraiment un usage qui a des conséquences
compulsives et excessives, qui a des conséquences sur la vie quotidienne.
Après, si vous aimez bien aller sur, je ne sais pas, un stade,
si vous êtes chez vous et vous dites, tiens, j'ai cinq minutes,
je vais aller regarder le compte de tel joueur ou de tel star,
je ne sais pas, de la télé-réalité, vous pouvez en fait le faire.
Si, en gros, ça n'interfère pas avec votre vie quotidienne,
si ça ne conduit pas à des conséquences négatives
d'un point de vue de votre santé mentale, il n'y a pas réellement de souci.
L'idée, en fait, c'est plus de se dire,
on arrive en usage problématique quand la personne, en fait,
se rend compte que sa influence de manière négative, son quotidien.
On comprend avec ce que nous dit Séverine Erel,
il n'est pas toujours simple de déterminer si notre usage des écrans
est problématique ou non.
D'autant plus que nous ne sommes pas tous égaux face à ces derniers.
Depuis le début, on désamorce un peu cette panique morale avec notre invité
et on essaye de nuancer le discours général.
En tout cas, celui qu'on entend tout le temps.
Pour continuer dans ce sens, on lui a demandé ce que pouvait nous apporter
les écrans d'un point de vue psychologique, évidemment.
Et quand on lui pose la question,
elle se tourne tout de suite vers le jeu vidéo pour nous répondre.
Il y a eu quelques études qui ont essayé d'évaluer jeu vidéo et santé mentale.
Et je trouve que ces études, les dernières études, elles sont intéressantes
parce qu'on est carrément sur de la télémétrie, c'est à dire
il y a des mesures objectives de temps de jeu vidéo et des faits,
en fait, sur la santé mentale.
Et en fait, il y a des associations très faibles, positives, très faibles,
entre pratiques du jeu vidéo et santé mentale.
De dire en gros, les jeux vidéo, c'est mauvais,
ben en fait, pour une majorité de personnes,
les jeux vidéo, en fait, c'est un lieu d'épanouissement
et c'est aussi une manière de répondre à certains besoins psychologiques.
Donc le jeu vidéo, en fait, il répond aux trois besoins psychologiques de l'humain.
Le premier besoin psychologique, c'est le besoin d'accomplissement.
Donc, c'est à dire réussir, par exemple, ces niveaux.
Deuxième besoin psychologique, ça va être le besoin d'autonomie.
Donc, c'est garder une forme de liberté, s'évader à l'intérieur du jeu vidéo,
pouvoir être peut-être plus libre que dans le monde réel parfois,
ce qui était le cas pendant le confinement.
Le troisième besoin psychologique, c'est le besoin de relations sociales,
c'est à dire pouvoir y rencontrer aussi des personnes.
Donc moi, je connais beaucoup de gens autour de moi
qui ont des amis uniquement dans le jeu vidéo,
qu'ils n'ont jamais vu dans la vie réelle
ou qui finissent par se rencontrer au bout d'un moment
à force de jouer ensemble et de se retrouver.
Donc voilà, donc le jeu vidéo, il répond à ces trois besoins psychologiques là.
Et ce jeu vidéo, et notamment par le fait qu'il permet en tout cas
d'offrir cette forme de liberté, il va aussi de cette forme d'autonomie,
il va fournir, il va être vecteur, en fait, de ce qu'on appelle le flot.
Donc le flot, c'est un état d'absorption intense
qui va en fait faire qu'on oublie le temps,
on oublie ce qui se passe autour de nous,
on est complètement focalisé dans la tâche,
on ressent en fait une forme de bien-être.
Et cet état de flot, à mon sens, il est intéressant
parce que justement, il aide d'une certaine manière
les personnes qui peuvent avoir une forme de stress
à réguler un peu mieux aussi leurs émotions.
C'est à dire, quand je suis en état de flot,
cet état va faire que tout ce qui est relatif à la conscience de soi
et à tout ce qui fait des processus,
alors nous, on appelle ça au processus auto-référencé,
mais c'est le processus où on va ressasser des choses de sa vie quotidienne,
voilà, toutes les formes d'anxiété.
En fait, dans l'état de flot, ces éléments-là vont diminuer
et toute notre attention va être focalisée en fait sur le jeu.
Et ça, pour des personnes, ça peut être une manière
au moins de se distraire de manière plaisante
ou alors en tout cas d'éviter le stress de la journée,
les soucis de la vie quotidienne, etc.
En même temps, j'ai un peu de mal à mettre que tous les jeux vidéo ont le même panier.
Je vais dire, un Walking Simulator comme Firewatch,
un Zelda Breath of the Wild et un Call of Duty,
pour moi, c'est des expériences complètement différentes.
Du coup, quels éléments des jeux vidéo amènent à cet état de flot ?
Comment ça marche face à la variabilité des expériences du jeu vidéo ?
Alors, c'est effectivement la variabilité des expériences du jeu vidéo.
Ensuite, il faut comprendre qu'on a chacun des styles particuliers
et on utilise le jeu vidéo aussi pour des raisons différentes.
Donc, il y a des personnes qui vont venir chercher le bonheur,
ça va permettre de répondre à des besoins
et puis le plaisir qui est plus l'idée d'activer les récompenses.
Donc, quand ça commence à être un usage excessif,
les gens ont tendance à plus chercher du plaisir dans le jeu vidéo que le bonheur.
Et par contre, l'idée, c'est d'essayer de trouver un peu l'équilibre
entre les deux, entre bonheur et plaisir.
Alors, quand je dis bonheur, en fait, en psycho, on parle d'état
«eutimique», donc c'est le terme scientifique pour ça.
Voilà, c'est un état, en fait, où on va être
réellement dans la réponse des besoins psychologiques.
Si on reprend le jeu vidéo, en fait, on a trois structures.
On a la plateforme, on a le gameplay.
Donc là, en fait, c'est l'ensemble des actions qui sont offertes.
Donc, on va retrouver la composante jouabilité,
les mécaniques de jeu et aussi la maniabilité
du jeu. Et la troisième partie du jeu, c'est l'artwork,
donc c'est la porte mentale.
Et donc, en fait, cette structure-là, si elle est bien construite,
elle va permettre de générer du «game flow», c'est-à-dire
cet état d'absorption à l'intérieur du jeu qui procure du plaisir
et qui fait qu'on a envie de venir rejouer.
Vous allez, en fait, en fonction de ces différents éléments,
pouvoir entrer ou pas en «flow».
Donc, par exemple, le gameplay va influencer le niveau de «flow».
Le «flow», en fait, c'est un équilibre entre les compétences
et les «challenges».
Si la mécanique de jeu est bonne, si les opportunités sont suffisamment
importantes et si la maniabilité est bonne, c'est un état
qui va être propice au «flow».
Mais ce qui va vous aider aussi à rentrer en «flow», c'est l'artwork.
Parce que dans l'artwork, on a la dimension graphique, sonore
et aussi la porte mentale, c'est-à-dire ce qu'on appelle la «game story».
Et donc, cette «game story», elle va faire qu'on va rentrer ou pas.
Moi, par exemple, j'avais beaucoup de mal à rentrer dans les «call of duty»,
parce que moi, les trucs de guerre,
même si le jeu peut être très bon et je peux m'amuser un petit peu,
voilà, moi, j'arrive plus à rentrer dans des petits mondes un peu roses,
avec des bonhommes rigolos, etc.
parce que ça me plaît beaucoup plus et que ça m'évade beaucoup plus.
La porte mentale, pour moi, est plus facile.
Mais c'est variable, en fait, entre individus.
Et ça, j'ai envie de dire, après, c'est compliqué de savoir
quel goût, ça dépend aussi de sa familiarité par rapport
à ce qu'on a pu faire avant.
Mais voilà, quand un jeu arrive, en fait, en tout cas,
à répondre et construit sur une plateforme donnée,
alors, quand je dis plateforme, c'est une console ou un ordi, etc.
S'il est bien construit du point de vue du gameplay
et si l'artwork, en fait, nous convient par rapport à nos attentes,
à nos goûts, à notre expérience,
ben là, en fait, on a de grandes chances de déclencher, en fait,
cet état de flow qui va être plaisant.
Cet état de flow, je me revois la voir plus jeune sur ma Nintendo DS
quand je jouais à Pokémon ou à Minecraft sur l'ordinateur.
Et à cette période, je revois aussi mes parents s'inquiéter
que je ne devienne trop addict au jeu vidéo.
Ce discours sur l'addiction et le jeu vidéo,
encore aujourd'hui, il reste très présent.
Et quand j'entends Séverine Ehrel nous parler de flow,
je me dis que ce sont deux choses qu'on a plutôt tendance à confondre, non ?
Alors, le flow et l'addiction, très clairement, c'est pas la même chose.
Donc c'est vrai que je passe souvent un peu de temps à essayer d'expliquer ça,
parce qu'en fait, ils sont effectivement souvent confondus.
Le fait de ressentir du flow dans un jeu vidéo, c'est pas un problème.
C'est un peu énervant pour les gens qui sont autour de vous,
parce que quand vous leur parlez, vous répondez pas,
ou quand vos parents vous disent de venir manger, vous venez pas.
Mais en fait, en soi, c'est pas de l'addiction.
C'est simplement un phénomène un peu attentionnel
où on est complètement absorbé dans la tâche.
Pourquoi est-ce qu'on confond souvent flow et addiction ?
Parce qu'en fait, il a été observé qu'il y avait des associations
entre le fait de ressentir du flow et de l'addiction.
Mais très clairement, en fait, c'est pas du tout la même chose.
Ce que je disais dans le tête que j'avais fait il y a quelques années,
il n'y a pas de problème à ressentir du flow dans un jeu vidéo.
C'est pas parce que vous vous êtes complètement absorbé
que vous devenez addict, en fait.
Et au contraire, c'est même les jeux sont construits, en fait,
pour vous créer cet état de flow.
Donc ce serait un petit peu embêtant.
L'addiction au jeu vidéo,
c'est le même principe que les usages problématiques d'Internet.
Donc dans les usages problématiques du jeu vidéo,
encore une fois, on va avoir un usage excessif
et compulsif du jeu vidéo qui va conduire à des conséquences
négatives dans la vie quotidienne.
C'est le même principe que les usages problématiques d'Internet.
Et effectivement, il y a des cliniques qui prennent en charge
les gens qui ont des difficultés avec le jeu vidéo.
Mais chez ces personnes-là, la difficulté,
le stress psychologique qu'ils ont va s'exprimer dans le jeu vidéo,
mais généralement, on va retrouver, en fait,
plusieurs, enfin, je l'appelle ça facteurs de risque
qui vont, en fait, amener à se réfugier,
en fait, dans le monde du jeu vidéo.
Et le problème, c'est que quand on commence
à gérer, en fait, son stress de cette manière-là,
après, en fait, il y a des mécanismes qui vont se mettre en place
et qui vont faire que, en fait, on aura tendance
à essayer de reproduire de plus en plus ce comportement au point
qu'on n'est plus vraiment, on contrôle plus vraiment.
C'est-à-dire, on a un stress psychologique
et on se réfugie tout de suite, en fait, dans le jeu vidéo.
Et plus on a de stress et plus on se réfugie.
Donc ça, c'est des mécanismes, en fait,
qui sont similaires à l'addiction, mais pas tout à fait.
Mais les addictions au sens,
on va dire, à l'alcool ou à l'addiction à des substances,
c'est un peu plus complexe que ça.
Ça reste donc un peu compliqué de parler d'addiction au jeu vidéo.
Mais alors, si on regarde d'un peu plus près
quand on s'intéresse à comment sont créés les jeux,
on retrouve un sujet sur lequel on parle beaucoup dans Acerty,
les mécanismes de rétention de l'attention.
Si on en retrouve dans la grande majorité de nos services numériques,
il faut dire que c'est dans le jeu vidéo
qu'ils sont particulièrement présents et visibles.
Qu'en pense notre invitée ?
Je pense qu'il y a un effort de réflexion et de régulation à faire,
en fait, sur le domaine du jeu vidéo, notamment
relativement aux ce qu'on appelle les dark patterns.
Les jeux vidéo sur consoles du genre Mario Kart, bon, c'est sympa.
On y passe du temps, on peut même y passer du temps en famille.
Et en soi, pour moi, c'est pas des jeux à risque.
Il y a d'autres jeux qui, effectivement, sont intéressants.
Fortnite, je trouve ça intéressant parce qu'effectivement,
on s'y retrouve, que les enfants s'y retrouvent, les jeunes ados,
qu'ils jouent ensemble, qu'ils font du lien et de l'association.
Donc c'est très bien.
Après, je pense que ces jeux, ils sont un peu prédateurs sur certains aspects.
Par exemple, sur Fortnite, il y a l'histoire de changement de saison.
Il faut absolument être présent au changement de saison.
Alors ça, en fait, on joue sur un dark pattern qui s'appelle le FOMO (Fear of Losing Something).
Autre aspect, dans Fortnite, en fait, on va retrouver une monnaie particulière,
donc le V-Bucks, qui est la monnaie qui a cours, en fait, dans Fortnite.
En fait, pour, par exemple, 20 euros, on va acheter, alors je sais plus combien.
Je me demande si c'est pas 7500 V-Bucks, mais il faut que je vérifie.
Et en fait, du coup, il y a ce qu'on appelle un dark pattern
qui s'appelle la confusion monétaire.
Et on se retrouve finalement à acheter des choses dans Fortnite
en n'ayant plus tout à fait conscience de la valeur qu'ils ont.
Et ça, déjà, c'est difficile pour nous, mais des enfants, en fait,
qui ont 10 ans, 11 ans, 12 ans, le cours de la monnaie dans Fortnite
plus le cours de la monnaie dans Rocket League, on ne sait plus, en fait.
Et cette confusion monétaire peut parfois pousser à faire des microtransactions,
en fait, un peu excessive.
Donc voilà, donc dans les jeux vidéo, on retrouve un peu ce jeu
sur des dark patterns de profs sociales comme le FOMO
ou d'autres types de dark patterns
qui vont jouer également sur des aspects confusion monétaire.
Et ensuite, dans le jeu vidéo aussi, ce à quoi il faut être vigilant,
c'est la symétrie informationnelle, c'est à dire qu'on a des jeux vidéo
qui, par exemple, vont être créés dans leur mécanique
pour nous pousser à faire des achats.
Il y a un super article, en fait, de King en 2019
qui montre ça plutôt pas mal.
Et enfin, qui montre ça assez bien.
Et en fait, dans cet article, ils sont allés voir les brevets
des éditeurs de jeux vidéo pour comprendre en fait
quelles étaient les mécaniques en dessous.
Et ce qu'ils ont pu observer dans cet article,
c'est qu'il y a des brevets, par exemple, qui ont été déposés
et qui sont basés sur l'idée d'une asymétrie informationnelle.
Donc, quand je dis asymétrie informationnelle, c'est à dire
l'utilisateur a moins d'informations, en fait,
que l'éditeur, que la personne, enfin que le jeu vidéo.
Donc, par exemple, moi, je vais me balader dans un monde virtuel
et puis je vais faire certaines choses, mais données vont être collectées.
Et en fait, le jeu va collecter
en fait toutes ces données, va se dire tiens, ça fait un moment
qui tourne à tel endroit.
Je vais essayer de lui envoyer une autre personne
ou je vais pousser à rencontrer une autre personne.
Et du coup, en magasin, je vais mettre en vente un objet
qui va lui permettre de battre cette autre personne qui est beaucoup plus forte.
Ça, en fait, c'est des principes, des petites mécaniques,
des petits systèmes informatiques qui vont faire en sorte que deux joueurs
qui ont des niveaux très différents se rencontrent.
Et en fait, le jeu va suggérer aux joueurs le moins bons
d'acheter une arme pour pouvoir en fait combattre
et gagner sur le joueur le meilleur et gagner en point d'expérience.
Sur la question du jeu vidéo,
je pense que ce serait bien de commencer à réfléchir
collectivement avec les éditeurs sur les aspects
microtransaction et asymétrie informationnelle
pour en fait limiter les risques monétaires pour les joueurs
et éventuellement, parce que ce n'est pas encore démontré,
les risques d'addiction, parce que quand on nous maintient
en fait sur un jeu,
moi, ça peut peut être aller parce que je n'ai pas de difficulté,
mais quelqu'un qui a des fragilités de base
est encore plus captif de ce type de système.
C'est déjà la fin de cet épisode
dédié à la place des écrans dans notre quotidien.
Un grand merci à Séverine et Réel pour avoir répondu à nos questions.
Pour continuer à creuser le sujet,
sachez que notre invité et sa collègue Anne Cordier
ont coordonné l'écriture du livre Les enfants et les écrans,
un ouvrage qui donne la parole à des chercheurs et experts de la question.
Les fonds récoltés serviront à financer deux associations,
les petits doudous et la quadrature du net.
Si cet épisode vous a plu et que vous l'écoutez sur un application de podcast,
on vous invite à nous donner votre avis dans l'espace dédié.
Et pourquoi pas, une bonne note, ça nous aide beaucoup.
En attendant le prochain épisode, merci de nous avoir écouté et on vous dit à bientôt sur C-Lab.
Sous-titres générés avec IA (Whisper), editing et proofing par Guglielmo Fernandez Garcia.
Créateurs et invités

![[Rediff] Y a-t-il un problème avec les écrans ? avec Séverine Erhel](https://img.transistor.fm/LKEQm4tKKSvNqpzrmI2Eq5EJwsnp4V0vLTA_yKo2ctQ/rs:fill:0:0:1/w:800/h:800/q:60/mb:500000/aHR0cHM6Ly9pbWct/dXBsb2FkLXByb2R1/Y3Rpb24udHJhbnNp/c3Rvci5mbS85NGM2/ZGUzMWVkZDI1NTA2/NGM1NjkzZmYwMThl/MjU0Yy5wbmc.webp)